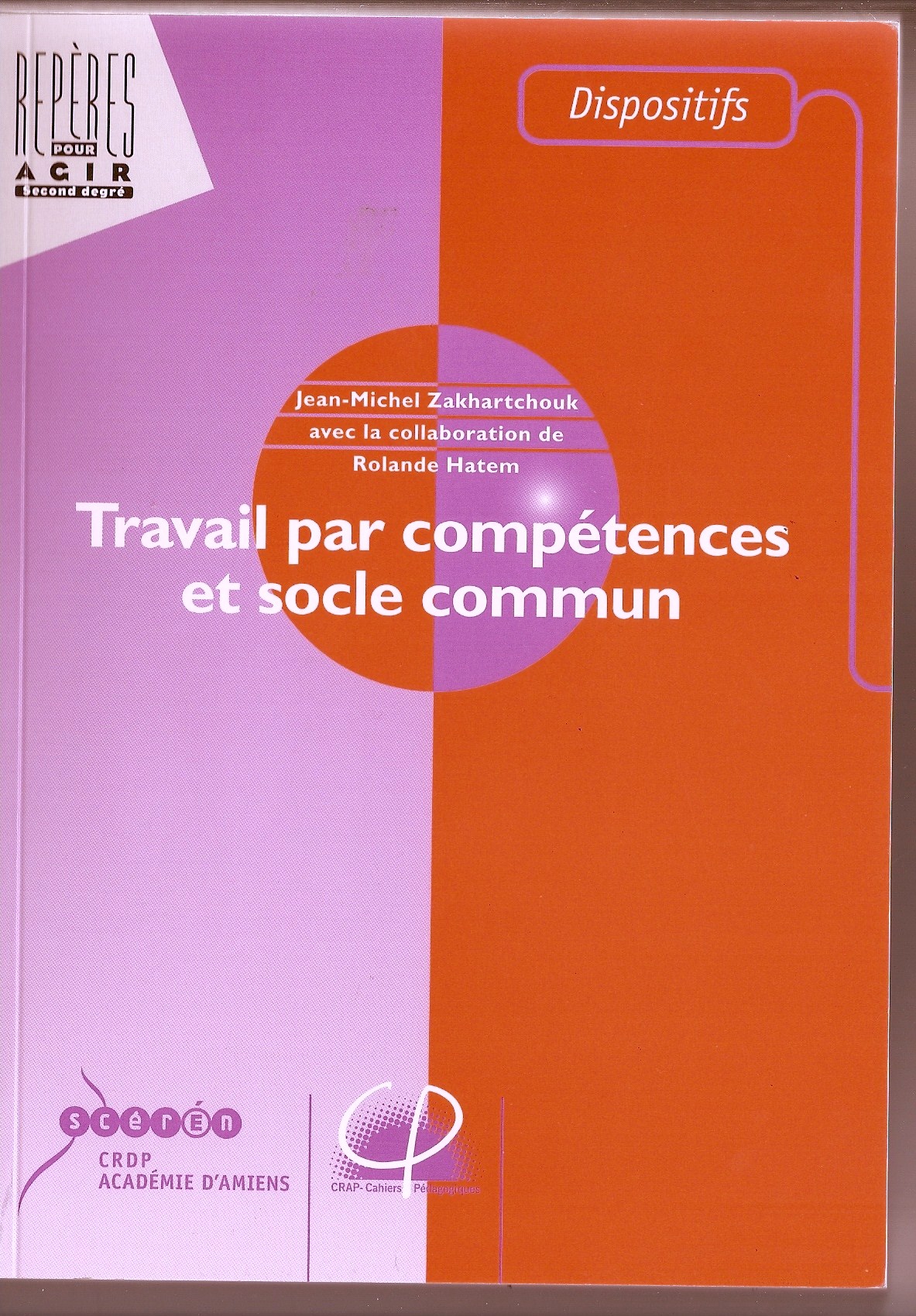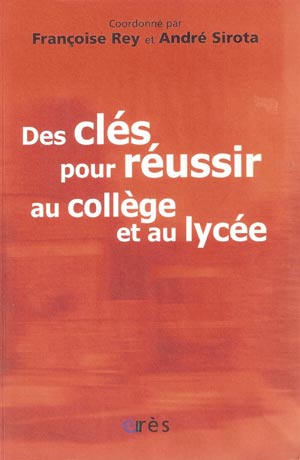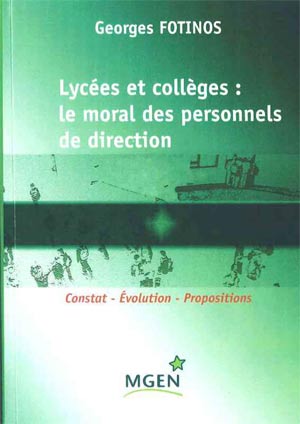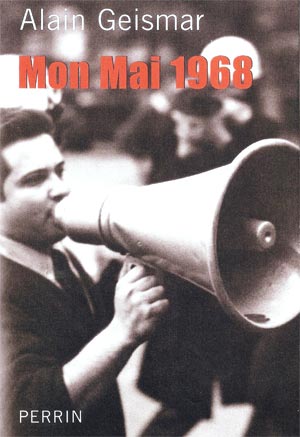I- Intervention de Pierre Madiot : La place de la parole dans l’institution scolaire
Lors du "5 à 7" du 18 février, Pierre Madiot qui vient de publier "L"école enfin expliquée aux parents" (voir les archives des "5 à 7") a axé son propos sur :" La place de la parole dans l’institution scolaire : parole magistrale, parole citoyenne, parole du sujet apprenant".
Intervention préparée pour ce "5 à 7" de l’Iréa :
INTRODUCTION
Une récente enquête de la DEPP (" Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance " ) a mis en évidence que les performances des élèves de CM2 en lecture, en orthographe et en calcul avaient significativement baissé entre 1987 et 2007. Une enquête de plus pour alimenter le discours récurrent dont l’objectif est de prouver la faillite du système scolaire tout entier, victime à la fois de l’illusion pédagogiste, du collège unique et de l’effondrement de l’autorité. a Bien plus, la note de la DEPP relève que « les inégalités sociales ont tendance à se creuser : la baisse constatée entre 1987 et 2007 n’a pas touché les enfants d’origine sociale favorisée. Ce résultat est cohérent avec le fait que la diminution des performances en lecture concerne plus particulièrement les élèves les plus fragiles. » Ainsi donc, nous serions confrontés à une double fatalité : -d’une part, plus le temps passe, plus le niveau baisserait, -d’autre part plus le niveau baisse, plus l’écart se creuse entre les catégories socioprofessionnelles. C’est un constat. Rien ne semble pouvoir y remédier puisqu’entre 1987 et 2007, il y a eu à peu près autant de gouvernements de droite que de gouvernements de gauche, avec autant de réformes et de contre-réformes et une multitude de dispositifs d’aide, de soutien et de remédiation. A chaque fois, le pouvoir a tenté d’agir tantôt sur l’organisation du système, tantôt sur la relation pédagogique, tantôt sur les programmes. Et l’on se dirige vers de nouvelles réformes vis-à-vis desquelles on peut nourrir le plus grand scepticisme dans la mesure où prétendant lutter contre l’échec scolaire en modifiant quelques structures (le temps scolaire, le pilotage de la formation des enseignants, une relative modularisation de la classe de seconde) elles laissent de côté le contenu des enseignements et la question du sens des apprentissages. Pas plus que la plupart des autres réformes, celles qui s’annoncent n’ont l’ambition d’entreprendre une réflexion globale sur les 3 pôles indissociables du système scolaire
– Le premier pôle, qui concerne les rapports entre les savoirs, les acteurs de l’école et l’environnement social, comprend autant la relation pédagogique que la confrontation entre les savoirs institués et les savoirs socialisés. Nous sommes là dans le domaine complexe de la parole singulière du sujet apprenant qui s’engage dans la recherche du sens.
- Le second pôle concerne ce que l’on doit apprendre à l’école. Autour de ce pôle s’est organisée une hiérarchie des savoirs et des savoir-faire qui sert de fondement à une hiérarchie sociale. La parole « scientifique » qui se déploie ici n’est évidemment pas exempte d’arrières pensées idéologiques.
- Le troisième pôle concerne la place institutionnelle que les enseignants, les élèves et les parents occupent à l’intérieur de l’école. C’est le pôle où chacun est appelé à se saisir d’une parole « politique » au sens où la politique concerne l’organisation de l’institution. Il se trouve qu’historiquement, l’école a été l’objet de débats et de réformes qui ont cherché à agir sur chacun de ces trois pôles dans le cadre d’un difficile et chaotique mouvement de démocratisation. Mouvement qui a ses avancées, ses reculs, ses coups d’arrêt, ses tentatives de clarification et ses ambiguités. Le constat de la DEPP semble d’un sombre pessimisme vis-à-vis de l’ évolution de cette démocratisation. Voyons comment cela s’est déroulé dans le temps et où nous en sommes aujourd’hui…
1) Le pôle de la relation pédagogique
On peut situer au temps de l’humanisme une première et vive confrontation entre d’une part, un enseignement scolastique, figé dans la certitude des vérités révélées et d’autre part une volonté d’amener l’homme à considérer le monde à partir de ses propres observations et de ses propres interrogations. Ce qui intéresse les humanistes, c’est le doute et le tâtonnement de l’élève qui cherche à comprendre plutôt que la certitude du maître qui assène la vérité. Et on verra comment ce pôle qui est celui où se tisse la « relation pédagogique » est tardivement revenu à l’ordre du jour dans l’histoire de l’enseignement. Dans ses Essais, au chapitre « De l’institution des enfants », Montaigne écrit :
« On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir ; et notre charge, ce n’est que redire ce qu’on nous a dit. Je voudrais qu’il corrigeât cette partie, et que, de belle arrivée selon la portée de l’âme qu’il a en main, il commençât à la mettre sur la montre lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d’elle-même quelquefois lui
ouvrant le chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour ». Non seulement, ici, Montaigne dénonce l’effet contre-productif d’un autoritarisme abêtissant mais ils propose une démarche fondée sur le pouvoir d’une parole chargée de sens.
– Parole de l’élève qui s’oppose au discours péremptoire et stéréotypé du maître scolastique : il faut que l’élève parle à son tour, qu’il s’aventure dans la résolution des problèmes, il faut, comme le dira plus tard Rousseau, qu’il « invente la science » et prenne la responsabilité du savoir qu’il va ainsi construire.
– La parole du maître ne disparaît pas pour autant, évidemment, mais elle se met en retrait par rapport à celle de l’élève « Je veux qu’il écoute son disciple parler à son tour ». Le maître joue alors le rôle d’une sorte de médiateur qui conduit l’élève vers une connaissance qui se trouve à portée de son regard, de ses observations et de son raisonnement.
Les deux paroles, celle du maître et celle de l’élève s’appuient sur l’expertise que l’un et l’autre sont capables d’exercer à partir de leurs expériences propres avant de la confronter à un savoir qui leur est extérieur. Ce premier axe, sur lequel tentent d’agir les humanistes, est donc celui du sujet apprenant remis en quelque sorte « au centre » de la démarche d’apprentissage. La critique des humanistes s’adressait ainsi aux « collèges » de l’époque au sujet desquels Rabelais et Montaigne n’hésitent pas à parler de « vrayes geaules de jeunesse captive » dans lesquelles « vous n’oyez que cris et d’enfans suppliciez, et de maistres enyvrez en leur cholere » et dont les élèves ressortent, comme l’écrit Rabelais à propos de la première éducation de Gargantua « fous, niais, tout rêveux et rassotés »… Derrière ces accusations de Montaigne et de Rabelais à l’encontre de l’éducation abrutissante que l’on destine à la future élite se profile la revendication d’une instruction destinée à des sujets libres, dotés d’une large part d’autonomie et de responsabilité. Il ne peut, dit Montaigne y avoir d’apprentissage dans la contrainte et dans la soumission
"J’accuse [= je condamne] toute violence en l’éducation d’une âme tendre, qu’on dresse pour
l’honneur et la liberté. Il y a je ne sais quoi de servile en la rigueur et en la contrainte ; et je tiens que ce qui ne se peut faire par la raison, et par prudence et adresse, ne se fait jamais par la force." On voit alors que donner la parole à l’élève au moment où il chemine vers le savoir lui donne un pouvoir sur sa démarche d’apprentissage. Pouvoir limité certes par les contraintes de la formation, mais qui suggère tout de même à Rabelais l’organisation de sa fameuse Abbaye de Thélème « Toute leur vie était employée, non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre[…] En leur règle n’était que cette clause : Fais ce que voudras " L’utopie imaginée par Rabelais ne trouvera une concrétisation que beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, entre autres grâce à Heinrich Pestalozzi, inspiré par les idées de Rousseau qui écrira dans l’Émile « Qu’il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même […]. Si jamais vous substituez dans son esprit l’autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet de l’opinion des autres. » La critique de la place de l’élève dans ses apprentissages entraîne donc une réflexion sur la place qu’il occupe dans le cadre qui est institué pour l’instruire. Les propositions de Rabelais dans l’Abbaye de Thélème et plus tard, celles de Pestalozzi dans son orphelinat de Stans accordent aux élèves une très grande liberté de mouvement et une très grande autonomie y compris dans les prises de décisions qui concernent le choix de leurs activités d’apprentissage. Au-delà de cet aspect pédagogique, c’est le rôle de l’école dans la société et la légitimité des savoirs qui est en question. Les principes de liberté et de responsabilité répondent en effet à des exigences de formation pour le présent scolaire mais aussi pour l’avenir de futurs adultes appelés à jouer dans la société un rôle actif et éclairé. Un bon exemple de cette relation entre les méthodes d’enseignement et la nature des rapports sociaux qu’elle induit nous est donné par l’histoire de l’enseignement mutuel au XVIIIe et au XIXe siècle.
C’est dès le milieu du XVIIIe siècle qu’est expérimentée cette méthode qui systématise le recours aux élèves les plus âgés ou les plus expérimentés pour enseigner aux plus jeunes ou aux moins avancés. [description] Même si elle maintient le maître dans une position « en suplomb », le fait de reconnaître aux élèves la capacité à exercer des responsabilités d’ordre pédagogique remet en cause l’ordre dominant qui réserve au maître l’exclusivité de la parole experte. Le rôle ainsi accordé à certains élèves ne donne certes à ces derniers qu’une prise très limitée sur l’organisation de l’espace, du temps et du dispositif pédagogique mais il présuppose que le savoir ainsi transmis est suffisamment proche des élèves pour que certains d’entre eux puissent en être porteurs auprès de leurs camarades… Non seulement des élèves peuvent alors se substituer momentanément aux maîtres, mais le savoir n’est plus la marque exclusive d’un pouvoir dominateur. C’est ce qu’en 1826 le futur Monseigneur Affre reproche à cette méthode : « Il est facile de sentir combien une telle méthode est vicieuse, puisque les enfants y apprennent de bonne heure à ne compter pour rien l’autorité de l’âge, à n’avoir de confiance que dans le mérite qu’ils se persuadent avoir. Quoi de plus propre à nourrir leurs dispositions à l’ambition, à l’orgueil, à l’indépendance, puisqu’on leur montre la facilité de devenir chacun à leur tour les chefs et les supérieurs de leurs condisciples. […]. C’est là évidemment un principe républicain ... » C’est pour ces raisons –politiques– que l’enseignement mutuel sera jugé suffisamment subversif pour être fermement combattu par les tenants de la transmission magistrale et qu’il sera éliminé dès les années 1830.
2) Le pôle des savoirs et de leur sens social On aborde alors un second pôle qui, à partir de la question de la place et du rôle de l’école dans la société, pose le problème des méthodes d’apprentissage et, finalement, celle du contenu des savoirs eux-mêmes.
C’est avec Condorcet, en 1792, que l’exigence de former de futurs citoyens vient dicter la nature des connaissances que l’école doit transmettre. Pour la première fois, un projet national assigne à l’école la mission de transmettre un savoir qui dépasse la dimension de simples rudiments à l’usage des pauvres et de marque de distinction à l’usage des possédants. Il s’agit d’ « Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins,
d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir leurs devoirs ; Assurer à chacun d’eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d’être appelé, de développer toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature, et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait, et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi : Tel doit être le premier but d’une instruction nationale ; et, sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. » Ce à quoi Napoléon répond qu’il est beaucoup plus urgent d’établir la hiérarchie entre les savoirs et entre les écoles, abandonnant, tout en bas de l’échelle, l’école primaire aux frères des écoles chrétiennes chargés d’enseigner les rudiments du « lire, écrire, compter » tandis que les maîtres et les professeurs devront « l’obéissance aux statuts, qui ont pour objet l’uniformité de l’instruction, et qui tendent à former, pour l’Etat, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ». Le problème est bien posé : d’un côté la conception d’un enseignement dont l’objectif est de permettre au citoyen d’exercer ses droits, de l’autre un enseignement dont le but est d’assurer un ordre fondé sur la soumission à l’autorité impériale… L’exigence démocratique en matière d’éducation est reprise en 1849 par Lazare Hyppolite Carnot selon qui l’instauration de la République et du suffrage universel induisent que le programme de l’enseignement obligatoire doit renfermer dorénavant « tout ce qui est nécessaire au développement de l’homme et du citoyen tel que les conditions actuelles de la civilisation française permettent de le concevoir […]. Puisque la libre volonté des citoyens doit désormais imprimer au pays sa direction, c’est en effet de la bonne préparation de cette volonté que dépendront le salut et le bonheur de la France » ( projet de loi Carnot de 1848 ). Ce à quoi Adolphe Thiers n’hésite pas à répliquer que « Ce serait une Folie funeste, celle qui consisterait à rendre l’ enseignement obligatoire […] L’enfant qui a trop suivi l’école ne veut plus tenir la charrue.[...] J’irais même jusqu’à dire que l’instruction est un commencement d’aisance et que l’aisance n’est pas réservée à tous.[...] En étendant moins l’enseignement, on aura plus d’argent à consacrer au service de l’inspection ... »
Enore une fois, on ne peut pas être plus clair : l’ordre social passe par moins d’instruction et plus de contrainte.
Ce débat fait rage jusque dans les années 1880 où Jules Ferry rend l’école publique, laïque et l’enseignement obligatoire dans le but de promouvoir les valeurs républicaines fondées sur la raison, sur la science et sur un idéal d’égalité. Pour Jules Ferry, non seulement le savoir est libérateur mais la manière dont on y accède contribue à former des citoyens éclairés. Jules Ferry n’est pas, contrairement à l’idée commune, le père de « fondamentaux » qui se résumeraient à quelques rudiments. Il est sensible aux méthodes actives et intuitives de ce qu’on appelle déjà la pédagogie nouvelle : observation, leçon de choses, musée scolaire, etc. À ses détracteurs qui lui reprochent de placer parmi les matières fondamentales « les éléments du dessin, du modelage et de la musique » Jules Ferry réplique : « Pourquoi tous ces accessoires ? Parce qu’ils sont à nos yeux le principal ; parce qu’en eux réside la vertu éducative, parce que ces accessoires feront de l’école primaire, de l’école du moindre hameau, du plus humble village, une école d’éducation libérale. » C’est ainsi qu’on a pu parler, à propos de Condorcet et de Ferry, des « fondamentaux de la citoyenneté » qu’il faut évidemment radicalement distinguer des « fondamentaux » qui dans l’esprit de Napoléon et d’Adolphe Thiers consistent à donner au peuple le minimum, et rien de plus…
3) Le pôle du partage des responsabilités Toutefois, dans l’école de Jules Ferry qui, par ailleurs, demeure fondamentalement inégalitaire puisque l’ordre du primaire réservé au peuple est séparé de l’ordre du secondaire où se forment les élites possédantes, l’implication des élèves dans une démarche éducative très modérément active ne s’accompagne encore d’aucune disposition qui donnerait aux élèves une prise sur l’organisation du cadre éducatif et encore moins sur l’organisation des activités. Il faut pour cela aller voir du côté des « écoles nouvelles » (école des Roches, écoles de Korczak, Makarenko, Ferrer, Dewey et, bien entendu Freinet) qui se développent, fin XIX et début XX, en marge des systèmes scolaires officiels.
On aborde là le troisième pôle sur lequel portent les transformations de l’école : celui de la répartition des pouvoirs et des responsabilités à l’intérieur de l’organisation de la classe et de l’établissement scolaire.
Les pédagogies actives du XIXe et du début du XXe siècle reposent sur l’idée humaniste selon laquelle apprendre est par essence un acte libre et volontaire. C’est pourquoi elles étendent le pouvoir de l’élève jusque dans la sphère du « politique ». On va alors créer des instances qui permettent aux élèves de peser, dans la limite des responsabilités que leur accorde leur statut d’élève, sur les décisions qui concernent l’agencement du temps et de l’espace. De plus, on invite l’élève à prendre une part active non seulement dans l’acquisition des connaissances mais aussi à jouer un rôle dans le déroulement de ses apprentissages. (Travail de groupe, projets, etc.) Si, dans l’école de Célestin Freinet, le maître reste le référent qui garantit la pertinence des situations d’apprentissage, qui planifie les progressions et qui valide les acquisitions, l’élève est investi de la responsabilité d’entrer de plain-pied dans une démarche de formation dont il pourra se déclarer l’auteur. Pour John Dewey comme pour Freinet, il s’agit de « faire des citoyens et non des savants ». Dès 1899, Dewey avance l’idée que « l’enjeu de l’éducation est de délivrer une pratique » d’essence démocratique avant de transmettre des connaissances formatées dont, à la limite, le sens resterait caché à la compréhension des élèves. Pour Dewey et pour Freinet, l’élève apprend en faisant et donne un sens aux savoirs dans l’instant où il les acquiert. On retrouve la même idée dans les « Classes nouvelles » mises en place par Gustave Monod après 1945 : « L’ordre de la classe, sa tenue intérieure et extérieure devront être confiés aux enfants eux-mêmes. Ils composeront une petite cité scolaire, où chacun aura sa fonction et sa responsabilité à l’égard de l’autre, démocratie en miniature où l’élève de sixième commence son apprentissage d’homme et où il découvrira la vie civique avec tout ce qu’elle réclame de sacrifices et de vertus. » Mais, même les classes nouvelles inventées par Monod en 1945 sont demeurées marginales. A la Libération, le système scolaire dans son ensemble reste conforme au modèle élaboré sous l’ancien régime par les Jésuites et par les Frères des écoles chrétiennes, puis réorganisé par Napoléon et revisité par Jules Ferry. La parole magistrale y garde la primauté malgré la volonté manifestée par les lois de 1880 d’offir au peuple autre chose que des rudiments de savoir.
En 1947, Henri Wallon rend le rapport commandé deux ans plus tôt à lui-même et à Paul Langevin. Ses conclusions sont sans appel : « Les études primaires, secondaires, supérieures sont trop souvent en marge du réel. L’école semble un milieu clos, imperméable aux expériences du monde. Le divorce entre l’enseignement scolaire et la vie s’accentue par la permanence de nos institutions scolaires au sein d’une société en voie d’évolution accélérée. Ce divorce dépouille l’enseignement de son caractère éducatif. » Même constat au congrès d’Amiens, en mars 1968, juste avant les événements de Mai : « Si l’élève manifeste peu de dynamisme c’est parce qu’on tente de lui transmettre un patrimoine qui lui est indifférent et qu’on transmet ce patrimoine à travers des modèles qu’il rejette ». Et le colloque débouche entre autre sur la conclusion que non seulement il est nécessaire de réformer les institutions, mais qu’il faut « transformer les relations pédagogiques ». Cette conclusion du colloque d’Amiens est tout à fait intéressante. La réponse qu’elle propose à la crise du système scolaire se veut globale : elle propose d’agir simultanément sur les trois niveaux que nous avons identifiés : celui de la relation entre le savoir, l’enseignant et le sujet apprenant, celui du contenu des programmes, celui de l’organisation institutionnelle. Mais la réforme Haby qui instaurera le collège unique en 1975 fera l’impasse sur les deux premiers pôles et concentrera ses efforts sur les structures du système sans remettre en cause ni les savoirs hérités du l’école élitiste ni le rôle des acteurs de l’école à l’intérieur de cette architecture. La crise constatée en mars 1968 ne pouvait, dans ces conditions, que s’aggraver. Les tentatives pour y remédier ont consisté, au cours des années 1980, et en particulier avec la loi d’orientation de 1989, à créer le conseil des délégués, le conseil de vie lycéenne et l’heure de vie de classe. Il faut bien voir, que la mise en place de ces instances représente quand même une avancée considérable dans la mesure où les élèves ne sont plus considérés comme des individus isolés les uns des autres mais comme un groupe capable d’élaborer une problématique propre et de faire valoir un point de vue. Le groupe des élèves accède ainsi à un statut qui lui donne une existence institutionnelle et donc la capacité de faire entendre une parole collective.
Reste à donner les moyens de faire en sorte que cette parole puisse être élaborée, exprimée, entendue, qu’elle débouche sur de véritables décisions et, au final, sur une formation de meilleure qualité. Reste à faire en sorte qu’elle ne se contente pas de se superposer aux autres aspects de la vie des établissements scolaires comme si elle était l’émanation d’une activité parallèle, voire concurrente, sans rapport avec le projet éducatif. Ce sont ces contradictions que le principe des TPE aurait pu contribuer à résoudre. Ce dispositif permet en effet de donner du pouvoir aux élèves dans le domaine de l’organisation de leur travail, dans la gestion de leur temps, dans la définition de leurs sujets d’étude et de leur production dans un cadre qui n’est plus le cadre figé du cours magistral et de la salle de classe. Ce dispositif permet en outre d’éviter la plupart des dérives qui consistent à accorder une importance disproportionnée à l’un des trois pôles (celui du savoir, celui du pouvoir, celui du sujet apprenant) ou à négliger l’imporance de l’un ou de l’autre. Si les préoccupations d’ordre organisationnel deviennent en effet prépondérantes, le système scolaire fonctionne sans contenu. Situation abondamment dénoncée par ceux qui crient à la baisse de niveau et à l’abandon des savoirs. (Mais on sait aussi que la focalisation sur les savoirs de haut niveau amène à n’accorder aux plus défavorisés que des rudiments de savoir tandis que l’élite peut accéder aux humanités et aux postes de responsabilité. C’est notamment le cas du lycée napoléonien.) A l’inverse, si l’élève n’a aucune prise sur le cadre à l’intérieur duquel on lui demande d’exister en tant qu’élève, il se retrouve dans la position du récepteur passif tandis que l’enseignant joue le rôle du « criailleur » dénoncé par Montaigne. Sans avoir pour autant beaucoup de pouvoir lui-même. Sans avoir non plus beaucoup d’efficacité. Dans tous les cas, lorsque ces nouvelles instances de concertation et de cogestion sont considérées comme des activités parallèles qui ne changent rien à la relation pédagogique, on met en scène les lieux du pouvoir sans donner de sens au rapport que l’élève entretient avec le savoir . On donne un alibi à l’autorité magistrale qui préside à la transmission des savoirs sans, finalement, donner plus de sens à la présence de l’élève dans l’école.
C’est peut-être sur ce dernier point que l’évidence de l’inadaptation de l’école est aujourd’hui la plus évidente tant l’écart entre l’école et la société, que signalaient Langevin-Wallon et le colloque d’Amiens, se creuse de manière de plus en plus insupportable. 4) On revient au sens social des savoirs Alors, nous revient en écho le propos des pédagogues humanistes. L’élève doit être considéré non seulement comme le destinataire des savoirs scolaires, mais aussi comme un individu singulier impliqué dans les interactions sociales du monde où il vit, de même qu’il est impliqué dans celles de son établissement scolaire tout autant que dans celles de sa classe. C’est ainsi qu’on en revient au premier pôle : celui de la relation que l’élève entretient avec le savoir et celui de la relation qu’il entretient intimement avec le sens social de ce savoir. Il y a besoin de reconnaître que, pour apprendre et se former autrement qu’en reproduisant des connaissances formelles, chaque élève doit établir un lien entre les savoirs institués et les savoirs vivants, entre la place qu’il occupe à l’école et celle qu’il occupe dans la vie sociale. Il y a nécessité de reconnaître que le sens que l’élève a besoin de rencontrer est quelque chose qui ne peut être imposé de l’extérieur mais qui se construit dans l’intimité des confrontations entre lui et le monde. Entre la parole scientifique qu’il doit utiliser dans sa confrontation à la connaissance et la parole politique qui lui permet de trouver sa place dans l’institution, on retrouve donc l’importance de la parole de celui qui dit « je ». C’est la parole qui permet à chacun de se situer par rapport à ses apprentissages mais c’est aussi celle que Henri Atlan, dans "Éducation et Vérité", appelle la « parole poétique », qui rend possible l’expression de l’émotion, de la souffrance, du plaisir et des sentiments singuliers. Au sein de la classe, c’est celle qui est utilisée par l’instance que, dans Analyse institutionnelle et pédagogie, René Lourau appelle le « groupe de base ».
A l’intérieur de ce groupe des élèves circulent toutes sortes de tensions et de relations interpersonnelles, toutes sortes de vécus, de représentations et de croyances, toutes sortes de façons d’appréhender les choses :
« société en miniature », ou plutôt communauté en puissance[…] cette tendance non-officielle, souterraine, souvent clandestine, informelle, cherchant sa « bonne forme » est tout aussi réelle que la tendance officielle, instituée, du groupe de travail. » En réalité, tout enseignant sait que, dans sa classe, il ne lui suffit pas de se référer au savoir ni à son propre statut de représentant de l’autorité pour obtenir le calme et pour faire apprendre les élèves. De la même façon, chaque enseignant sait bien que pour transformer le rassemblement d’élèves qui constitue le groupe classe en un groupe apprenant, il lui faut non seulement prendre en compte les réalités sociolologiques, économiques et culturelles des élèves mais aussi les réalités affectives du groupe : ses tensions, ses réseaux et ses projets. Là se joue ce que Bernard Charlot et Jacky Beillerot appellent le « rapport au savoir » et qui constitue un " processus par lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de nouveaux savoirs singuliers lui permettant de penser, de transformer et de sentir le monde naturel et social " Qu’est-ce que cette prise en compte implique aujourd’hui ? Prendre en compte cette réalité de l’élève confronté -à son rapport intime au savoir, -au rapport entre ce savoir et le monde, -au rapport entre sa propre recherche du sens et celle du groupe auquel il appartient, suppose que l’institution scolaire, le maître et les savoirs institués cessent de se présenter comme des instances qui s’opposent à lui. Du côté du pôle de la parole du sujet apprenant, il faut qu’ à l’intérieur de la classe soient institués des moments et des procédures qui permettent que les tensions soient régulées, les conflits apaisés, les difficultés exprimées. Que soient ménagés des dispositifs qui permettent aux élèves d’exprimer
– les sujets sur lesquels porte leur désir d’apprendre,
– les émotions, les interrogations que ces sujets soulèvent en eux
Du côté du pôle des savoirs, il faut que les objets d’étude puissent, à un moment, être reliés aux centres d’intérêt des élèves et à la réalité de leur environnement
Ceci suppose que l’école soit insérée dans le tissu socio-économique à l’image de ce qui a pu exister dans les ZEP lorsque le projet éducatif était le résutat d’un travail commun entre les établissements, les parents, les associations et les collectivités locales. Ceci suppose aussi que cesse la rupture entre l’école et les parents de manière à ce que, chacun à sa place et chacun dans le rôle que lui confère son statut, parents et enseignants accompagnent ensemble les enfants-élèves dans la découverte du sens. Du côté du pôle de l’organisation de la classe et de l’établissement, il faut que les élèves aient l’occasion d’exister en tant que force de proposition. Dans la classe : qu’ils puissent effectuer de manière autonome et différenciée des travaux de recherche et de production qui fasse appel à leur créativité et à leur responsabilité. Dans l’établissement : qu’ils puissent faire entendre leur point de vue dans la gestion du temps, de l’espace et des moyens mis à leur disposition pour se former. Cette école-là est démocratique parce qu’elle est efficace et elle est efficace parce qu’elle est démocratique. Et elle ne peut être démocratique que si l’on donne aux trois pouvoirs de la parole : la parole scientifique, la parole politique et la parole du sujet apprenant les moyens d’exister en occupant chacune toute la place qui lui revient.
5) L’échec scolaire n’est pas une fatalité La double fatalité mise en évidence par l’enquête de la DEPP n’est pas irrémédiable. On ne peut certes pas contester les conclusions générales des enquêteurs de la direction de l’évaluation, de la prospective et des performances. Mais il faut aussi aller voir sur le terrain, là où peuvent se trouver démentis leurs diagnostics pessismistes. En observant les résultats des tests d’entrée en sixième, les services du rectorat de Nantes ont observé une réussite significative d’ élèves provenant de quelques écoles situées en ZEP. L’enquête qui a alors été menée auprès d’un échantillon représentatif d’écoles a mis en évidence que les résultats des élèves des zones d’éducation prioritaire étaient meilleurs que ceux des élèves d’écoles ordinaires lorsqu’existaient : - des relations fortes avec les parents
– des enseignants soucieux des droits et des devoirs des élèves qui s’efforcent constamment de valoriser les élèves
– Une qualité de la réflexion concernant la didactique et la pédagogie - cohérence de formation (conseils d’école globaux et conseils de cycle, classeur mémoire) - priorité accordée à la dimension langagière (oralisation, écrits variés) - sens donné aux tâches à effectuer et aux apprentissage (projets, contexte authentique résolution de problème) - diversification pédagogique et reponsabilisation (autoévaluation, travaux de groupes, activités variées en parallèle selon une stratégie de « travail personnel contractualisé ».. - attention constante aux élèves en difficulté (PPAP par cycle, coopération avec le réseau d’aide) - souci de cohérence avec l’enseignement au collège (prise de relais plus attentive par les collèges inéfficacité des remédiations : prendre le problème à l’origine)… Le récent travail de l’équipe d’Yves Reuter sur l’école Freinet de Mons en Barœul coorobore totalement ces constatations.
CONCLUSION
Pour en revenir à l’enquête de la DEPP, on veut bien croire que les résultats globaux sont justes. Et il faut reconnaître aux enquêteurs le fait qu’ils ont entouré leurs observatiuons et leurs conclusions de toutes sortes de précautions grâce auxquelles ils ont sans doute évité les interprétations hâtives. On doit cependant remarquer qu’ils ont procédé à une évaluation des résultats d’ensemble et non à celle des méthodes et des différents dispositifs qui produisent de l’échec ou de la réussite. Cela n’empêche pas les adversaires de la pédagogie d’affirmer que les méthodes traditionnelles seraient, de toute façon, les meilleures puisqu’elles « auraient fait leurs preuves » tandis que les méthodes dites « actives » auraient massivement échoué… On a vu que ces évaluations existent et qu’elles vont dans le sens de la reconnaissance d’une plus grande efficacité de l’école lorsque cette dernière met en œuvre une pédagogie qui se réclame des valeurs de la démocratie.
Avoir peur de la pédagogie, ne serait-ce pas avoir peur de la démocratie ?
– Pour en revenir à l’enquête de la DEPP, on veut bien croire que les résultats globaux sont justes. Et il faut reconnaître aux enquêteurs le fait qu’ils ont entouré leurs observatiuons et leurs conclusions de toutes sortes de précautions grâce auxquelles ils ont sans doute évité les interprétations hâtives. On doit cependant remarquer qu’ils ont procédé à une évaluation des résultats d’ensemble et non à celle des méthodes et des différents dispositifs qui produisent de l’échec ou de la réussite. Cela n’empêche pas les adversaires de la pédagogie d’affirmer que les méthodes traditionnelles seraient, de toute façon, les meilleures puisqu’elles « auraient fait leurs preuves » tandis que les méthodes dites « actives » auraient massivement échoué… On a vu que ces évaluations existent et qu’elles vont dans le sens de la reconnaissance d’une plus grande efficacité de l’école lorsque cette dernière met en œuvre une pédagogie qui se réclame des valeurs de la démocratie.
Avoir peur de la pédagogie, ne serait-ce pas avoir peur de la démocratie ?

- .
–




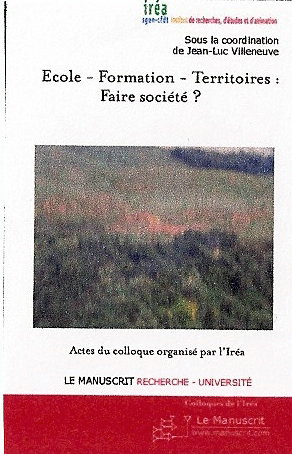
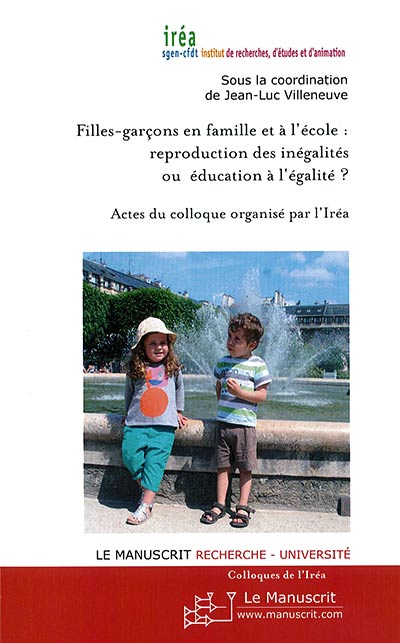
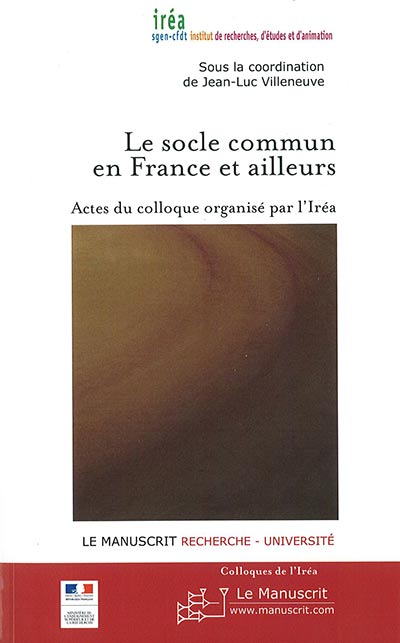
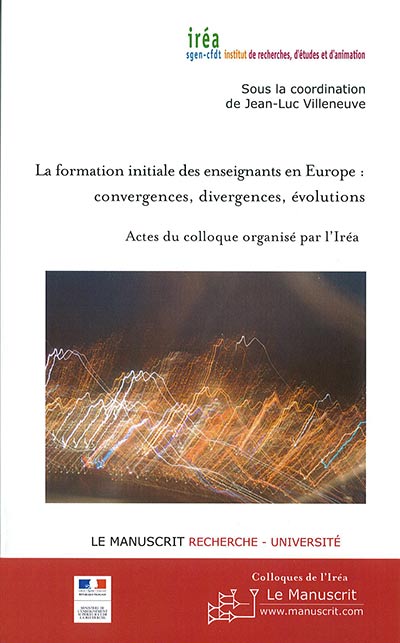
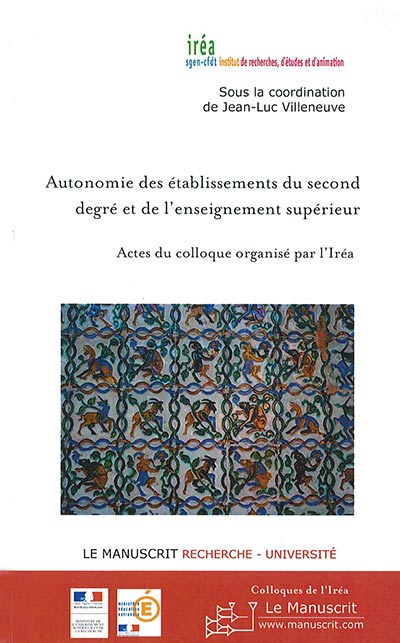
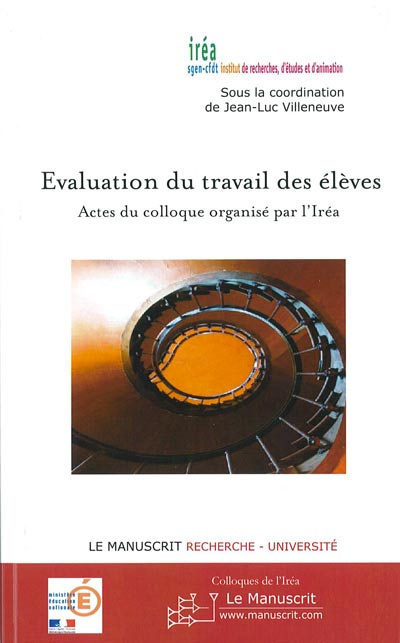
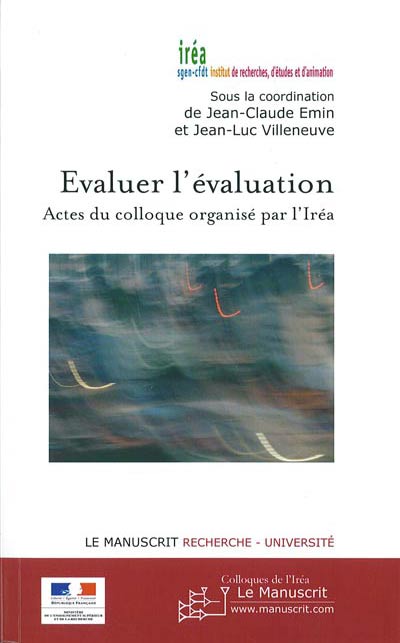
 Imprimer
Imprimer